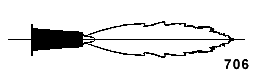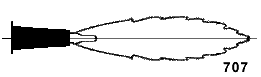5. LES TROIS ZONES DANS LA FLAMME
Dans
un chalumeau soudeur, cette combustion n'est pas instantanée mais
se réalise en deux temps![]() qui font
apparaître dans la flamme trois zones distinctes au regard
du schéma 705 :
qui font
apparaître dans la flamme trois zones distinctes au regard
du schéma 705 :

5.1. Zone 1, primaire ou dard, température ~3050°C :
- dard éblouissant de forme généralement conique, correspondant au début de la réaction du mélange à volumes égaux oxygène/acétylène créé au niveau de l'injecteur du chalumeau soudeur oxyacétylénique.
La réaction incomplète qui se produit forme un mélange très réducteur d'oxyde de carbone CO et d'hydrogène H2,et donc écrire les réactions de combustions suivantes :
C2H2
+ O2![]() 2CO
+ H2 + 106000 calories
2CO
+ H2 + 106000 calories
5.2. Zone 2, neutre, normale ou réductrice, température ~3100°C :
- entre le panache (ou flamme secondaire) se trouve une courte zone bleue, essentiellement réductrice par sa composition (2CO + H2), ses contours sont moins nets que la zone primaire (zone 1), c'est la zone "active de la flamme".
- grâce à sa nature chimique réductrice, elle empêche l'oxydation du métal chauffé et peut même désoxyder celui-ci en sa surface.- c'est l'endroit le plus chaud, car une très grande partie des calories se trouve disponible dans cette zone du fait de la première combustion, également appelée "combustion primaire".
5.3. Zone 3, secondaire ou panache, température ~2750°C :
- panache beaucoup moins lumineux où l'oxygène de l'air fait l'appoint pour obtenir la combustion complète des gaz résultants de la réaction (zone primaire).
- nous pouvons symboliser l'air qui contient 1 volume d'oxygène pour 4 volumes d'azote (O2 + 4N2) et donc écrire les réactions de combustions suivantes :
2CO
+ (O2 + 4N2)![]() 2CO2
+ (4N2) + (2 x 68000 calories)
2CO2
+ (4N2) + (2 x 68000 calories)
H2
+ 0,5 (O2 + 4N2)![]() H2O
+ (2N2) + 48000 calories
H2O
+ (2N2) + 48000 calories
- les 2,5 volumes d'oxygène introduits soit directement (1 volume), soit en provenance de l'air ambiant (1,5 volumes) brûlent 1 volume d'acétylène.
- l'azote n'est pas intervenu, c'est seulement un diluant de la flamme, ce qui explique la longueur du panache.
flamme dure, haute vitesse de sortie
flamme douce, basse vitesse de sortie
6. PARTICULARITES DE LA FLAMME OXYACETYLENIQUE
La flamme se formant à la sortie d'un bec de chalumeau soudeur oxyacétylénique, se présente toujours de façon identique si elle est destinée à produire une température élevée, elle comprend :

- Un dard, schéma 708, qui est la surface sur laquelle se produit la combustion du mélange de gaz comburant (oxygène) et de gaz combustible (acétylène), introduit dans le chalumeau oxyacétylénique. Cette combustion dite "primaire" qui porte les produits de combustion à une température très élevée, généralement, la température maxima de la flamme (~3100°C) se situe au voisinage immédiat de l'extrémité du dard .
- Un panache, schéma 708, qui est le volume occupé par les gaz brûlés, rendus visibles en raison de leur température, et auxquels vient se mêler l'air ambiant. Cet air ambiant abaisse progressivement la température des gaz brûlés au fur et à mesure qu'on s'éloigne du dard, à une certaine distance de celui-ci, le mélange cesse d'être visible et le panache disparaît, mais généralement, la combustion primaire est incomplète et, dans ce cas, le panache est le siège de combustions secondaires avec l'oxygène de l'air ambiant comme carburant. Ce phénomène qui s'accompagne d'un dégagement de chaleur, compense, au moins dans une certaine zone enveloppant le dard, l'effet refroidissant de l'air ambiant décrit ci-dessus.
6.1. Du point de vue thermique :
- Pour pouvoir souder, ou exécuter un chauffage localisé, la flamme doit avoir une température maxima, la plus élevée possible, pour une combustion primaire suffisamment limitée, afin que cette température maxima ne s'abaisse ensuite que lentement, grâce aux combustions secondaires, au fur et à mesure que l'on s'éloigne du dard, de toute les flammes, c'est la flamme oxyacétylénique qui répond au mieux à cette condition.
- Le choix de l'oxygène comme gaz comburant s'impose déjà par le fait qu'on évite ainsi d'introduire inutilement dans la flamme de l'azote (l'air ambiant comprend 4/5 d'azote) qui, ne participant pas aux combustions, prend une partie importante de la chaleur dégagée et abaisse la température maxima.
- Le choix de l'acétylène comme gaz combustible tient au fait qu'en brûlant, ce gaz dégage non seulement la chaleur d'oxydation de chacun de ses constituants (carbone et hydrogène) mais encore une énergie considérable provenant de sa décomposition. Parmi les gaz combustibles usuels, l'acétylène est seul à posséder cette particularité qui confère à la flamme des propriétés réellement exceptionnelles, ainsi pour un mélange en parties égales (rapport de combustion r = 1/1), alimentant le chalumeau soudeur, on obtient dans la flamme oxyacétylénique une température maxima de ~3100°C qui est la plus haute de toutes les flammes usuelles. En outre, lorsque la flamme est réglée pour obtenir cette température maxima, la combustion primaire conduit à la formation de deux gaz, eux-mêmes combustibles, l'oxyde de carbone et l'hydrogène, qui, brûlant à leur tour dans la panache, vont encore dégager une quantité de chaleur considérable dans les combustions secondaires.
6.2. Du point de vue métallurgique :
- Pour le soudage et le traitement thermique localisé des métaux, il faut protéger le métal contre l'action de l'oxygène de l'air, mieux il faut le plus souvent, pouvoir "réduire" (détruire) les oxydes qui ont pu se former ou qui peuvent persister, là encore la flamme oxyacétylénique répond au mieux à cette condition. En effet, dans la région voisine du dard celle-là même qui est utilisée en raison de sa température la plus élevée, l'atmosphère de la flamme (obtenue à partir du rapport de combustion r = 1/1) est composée uniquement d'oxyde de carbone et d'hydrogène, deux gaz extrêmement "réducteurs" et aptes à protéger le métal de l'oxydation. Aucune autre flamme ne peut apporter une meilleure solution au problème posé.
6.3. Du point de vue pratique :
- La flamme oxyacétylénique possède un avantage qui lui est également propre, c'est son réglage. En effet par rapport à une flamme normale (neutre ou réductrice, rapport de combustion r = 1/1), si on augmente la proportion d'acétylène, il apparaît un dard brillant (auréole) qui, se superposant au dard normal, s'allonge au fur et à mesure que croît la teneur en acétylène, on obtient alors une flamme carburante. A l'inverse, si, par rapport à la flamme normale (neutre ou réductrice, rapport de combustion r = 1/1), on augmente la proportion d'oxygène, le dard se raccourcit ainsi que le panache, on obtient une flamme dite oxydante.
- Ainsi donc, pour régler une flamme oxyacétylénique afin d'obtenir une flamme normale (neutre ou réductrice, rapport de combustion r = 1/1), la plus couramment utilisée, il suffit de partir d'une alimentation conduisant à une flamme carburante (excès d'acétylène) et d'augmenter progressivement l'alimentation en oxygène du chalumeau (ou de diminuer l'alimentation en acétylène) jusqu'à effacer le dard brillant, à ce moment, on obtient, et de façon précise, le réglage désiré, il est à préciser que le dard brillant de la flamme carburante (excès d'acétylène) résulte de la présence transitoire de carbone libre porté à très haute température et très lumineux. Ceci justifie dans certains cas l'emploi de cette flamme lorsqu'on veut, soit assurer une réduction énergique d'oxydes, soit maintenir ou obtenir une teneur élevée du carbone dans un métal au cours du soudage, du rechargement ou de traitements particuliers comme une cémentation, par exemple.